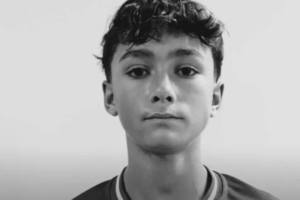L’apnée du sommeil touche 3 millions de personnes en France, soit 4 à 10 % de la population du pays. Chez les plus de 70 ans, ce chiffre s’élève à 15 %. Alors pour aider les patients, des traitements se développent. Dernier en date : une opération destinée à ceux qui ne supportent pas les soins classiques. Elle est autorisée en France depuis fin 2024 et est réalisée dans un seul établissement à Toulouse, l’hôpital Larrey.
L’apnée du sommeil, qu’est ce que c’est ?
L’apnée sur sommeil se manifeste par une pause de la respiration durant le sommeil, en raison du bouchage des voies respiratoires. Généralement, les muscles de la langue sont en cause : ils vont se relâcher et pousser la langue vers les voies aériennes. Résultat : la respiration est impossible.
Rappelons qu’aujourd’hui, le traitement de l’apnée du sommeil est assez codifié. « Cela se fait soit par orthèses d’avancée mandibulaire — une sorte de gouttière qui poussent la mâchoire inférieure en avant et empêchent la langue de se replier et de bloquer la voie aérienne —, soit par PPC — pression positive continue, il s’agit d’un appareil qui, pendant la nuit, envoie de l’air dans les voies respiratoires — », explique le Dr Benbassat, ORL et chirurgiens cervico-facial. Mais quelques fois, ces traitements ne sont pas concluants.
Une décharge électrique
Face à ces traitements inefficaces chez certaines personnes, une opération a ainsi été développée en 2014 et est autorisée en France depuis fin 2024 seulement.
Concrètement, l’opération se fait sous anesthésie générale. Elle consiste à « réaliser une incision au niveau du pectoral puis une autre au niveau du cou. On va ensuite implanter une sorte de pacemaker connecté au nerf hypoglosse par des électrodes. Il est situé dans la région cervicale et joue un rôle clé sur le contrôle de la langue. À chaque fois que la personne va respirer, le pacemaker va envoyer une petite décharge électrique qui va rigidifier la langue et donc l’empêcher de bloquer les voies aériennes », ajoute le Dr Benbassat.
Mise en place du dispositif
Une fois le pacemaker implanté, « la thérapie est activée au bout d’un mois. Le patient est muni d’une télécommande pour régler l’intensité de la décharge, un peu comme les électrodes chez le kiné. On prérègle l’intensité à l’hôpital, puis chaque soir avant d’aller se coucher, il enclenche son dispositif qui met une vingtaine de minutes à se lancer », complète le chirurgien.
Une heure d’arrêt du dispositif est aussi programmée et le patient est libre d’appuyer sur pause en cas de réveil nocturne. « L’opération comporte peu de risque, c’est une chirurgie relativement facile. Le seul effet secondaire constaté est un engourdissement de la langue au réveil, qui dure quelques minutes, en raison de l’électrode positionnée sur cette dernière ».
Des critères pour être opéré
Cette opération ne se réalise pas chez n’importe qui. « On la propose chez les patients qui développent une intolérance ou une inefficacité de la gouttière ou du PPC. Il faut absolument qu’ils aient testé les deux pour recourir à l’opération », complète le docteur.
Par ailleurs, « préalablement à l’opération, nous réalisons une endoscopie, afin de constater où les voies respiratoires sont bloquées. L’aspect anatomique joue dans cette opération ». Pour l’heure, cinq patients ont été opérés à Toulouse et chez deux d’entre eux, « on a constaté une baisse de nombre d’apnées du sommeil ».