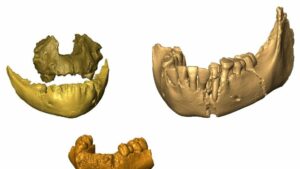Un emballement scientifique. Le 17 avril dernier, le Pr Nikku Madhusudhan et son équipe publiaient une étude au retentissement médiatique spectaculaire. Les chercheurs affirmaient avoir détecté du sulfure de diméthyle (ou DMS) dans l’atmosphère de K2-18b, une exoplanète située dans la constellation du Lion, à environ 124 années-lumière de la Terre (soit environ 1,173 x 10¹⁵ km).
Ce composé chimique est, sur Terre, exclusivement produit par des organismes vivants (en particulier par les phytoplanctons marins). Immédiatement, le professeur de l’université de Cambridge le qualifie de « plus grand signe d’activité biologique en dehors du système solaire ». Il n’en fallait pas plus pour déclencher un emballement médiatique et scientifique.
De nombreux titres évoquent alors la potentielle découverte de vie extraterrestre. Mais cette interprétation, séduisante, glisse rapidement du domaine de l’hypothèse vers celui de la spéculation. Benjamin Peter, expert à la Cité de l’espace, nous aide à démêler les faits de l’enthousiasme.
Une épopée scientifique qui débute en 2023
K2-18b n’est pas une inconnue pour les astrophysiciens. Elle a été détectée en 2015 grâce aux observations du télescope spatial Kepler. Avec une masse environ huit fois supérieure à celle de la Terre, cette « super-Terre » intrigue immédiatement. Elle orbite autour d’une naine rouge, K2-18, et se trouve dans ce qu’on appelle la « zone habitable » de son étoile (une région ni trop chaude ni trop froide, où l’eau pourrait exister à l’état liquide).
Problème : à plus de 100 années-lumière de distance, les instruments traditionnels sont impuissants. Il faut alors s’en remettre aux télescopes spatiaux. En particulier au James Webb, fleuron de la NASA lancé en 2021, qui permet d’analyser la composition chimique des atmosphères lointaines.
Ici, les scientifiques ont utilisé un instrument du télescope qui s’appelle MIRI. Il permet d’étudier l’atmosphère des exoplanètes via les ondes infrarouges. C’est ce qu’on appelle la technique du transit : on attend que la planète passe devant son étoile, et on analyse les signaux lumineux qui nous reviennent », explique Benjamin Peter, à la rédaction.
En 2023, une première étude évoque déjà la possible présence de sulfure de diméthyle dans l’atmosphère de K2-18b. En avril 2025, une seconde publication vient renforcer cette hypothèse. Le gaz est rare, et surtout, il est biologiquement associé à la vie sur Terre. Un signal faible, mais jugé suffisamment intrigant pour relancer la machine à hypothèses.
Le DMS, vraiment un « signe de vie » ?
Sur Terre, le sulfure de diméthyle est lié à la vie car il est rejeté uniquement par les phytoplanctons », précise l’expert toulousain.
Ce lien biologique alimente donc naturellement les spéculations. Mais faut-il pour autant y voir une preuve de vie ailleurs ? Pour une partie de la communauté scientifique, la réponse est non (ou du moins, pas encore).
Associer forcément le DMS aux phytoplanctons, et donc à une activité biologique, c’est un peu rapide », nuance Benjamin Peter.
Et d’ajouter :
C’est peut-être vrai sur Terre, mais il faut aussi dire que ce gaz a été retrouvé sur des comètes. »
Autrement dit : ce composé chimique pourrait très bien résulter de processus non biologiques dans l’environnement particulier de K2-18b.
Quand la prudence est de mise
Au-delà de l’interprétation biologique, d’autres éléments viennent nuancer les résultats. Premier point sensible : la détection du gaz elle-même.
Beaucoup d’astrophysiciens ont remis en question les éléments qui permettent d’affirmer la présence de ce gaz », explique Benjamin Peter.
Le signal est jugé trop ténu, voire trop proche du seuil de détection, pour tirer des conclusions fermes.
Autre problème : la distance très réduite entre K2-18b et son étoile. Seulement 21 millions de kilomètres, contre 150 millions pour la Terre et le Soleil. Cela pourrait induire des températures extrêmes, voire des conditions peu compatibles avec la vie telle que nous la connaissons.
Rien aujourd’hui ne permet d’affirmer que des traces de vie sont présentes sur K2-18b. Il faudra de nouvelles études, et des instruments encore plus performants », résume le spécialiste de la Cité de l’espace.
Bonne nouvelle : c’est prévu. L’exoplanète pourrait faire l’objet d’observations plus poussées avec ARIEL, un télescope spatial européen dont le lancement est prévu en 2028.
La quête de la vie extraterrestre
Malgré les remises en question, les travaux du Pr Madhusudhan s’inscrivent dans une ambition ancienne, presque universelle : celle de découvrir que la Terre n’est pas un cas isolé.
Tout l’enjeu de l’exobiologie et de l’astrobiologie, c’est d’essayer de comprendre pourquoi la vie ne se serait développée que chez nous », insiste Benjamin Peter.
Une interrogation qui résonne d’autant plus quand on sait que notre galaxie, la Voie lactée, abrite entre 100 et 400 milliards d’étoiles. Et que l’univers en contient des milliards d’autres. Face à cette immensité, l’hypothèse de la vie ailleurs paraît presque… logique.
Cette quête se poursuit à travers des missions emblématiques : les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars, les sondes envoyées vers Europe ou Encelade, et bientôt ARIEL pour les exoplanètes. Peut-être ces outils nous permettront-ils, dans les prochaines décennies, de passer des questions « y a-t-il d’autres formes de vie ? » à « où sont-elles ? ». Et même plus tard : « comment les comprendre ? »
>> À LIRE AUSSI : Après 53 ans en orbite, cette sonde soviétique vient de retomber sur Terre