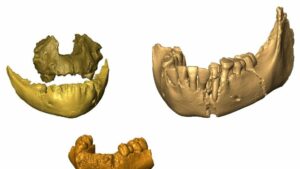Il y aurait beaucoup à dire sur le scandale qu’offre à beaucoup de catholiques et de Français la nomination par l’archevêque de Toulouse de son chancelier. Il est vrai qu’en général, ce genre de fonction n’attire pas la lumière, comme le note le communiqué de presse de l’archevêque en date du 10 juillet. C’est une tâche d’archives, écrit-il.
Le droit canonique en dit un peu plus sur les fonctions d’un chancelier, qui, s’il fait fonction d’archiviste, c’est au titre d’un rôle plus décisif dans la vie d’un diocèse. Un évêque préside un certain nombre de conseils diocésains, prend des décisions concernant les biens et les personnes de son diocèse, et cela va jusqu’aux décisions disciplinaires qu’il peut prendre, ainsi que les décisions en nullité de mariage, etc. De tous ces actes, le chancelier est le rédacteur, au sens où ce n’est pas en pratique à l’évêque de préparer tous les documents qui seront ensuite présentés à sa signature.
Le droit canonique précise encore que, si ces actes doivent avoir un effet juridique, ils doivent être signés non seulement de l’évêque mais « pour la validité, en même temps par le chancelier » (can. 474). Si la charge de chancelier est effectivement une tâche administrative, et peut ne pas être vue comme une promotion par l’archevêque de Toulouse, elle n’est pas subalterne, et touche à des matières sensibles. Pour toutes les décisions issues d’un procès, il revient au chancelier de les enregistrer et de les diffuser. Les enquêtes de la Ciase et de la police dans certaines affaires plus récentes ont montré l’usage des chancelleries de détruire les pièces concernant les prêtres pédophiles.
La réputation
Pour en rester aux arguments canoniques, que dit ensuite le communiqué de Toulouse ? Il veut répondre à la remarque qui a été portée à la connaissance de l’évêque par des chrétiens choqués de cette nomination, à propos du can. 483, alinéa 2 (On voit bien que les fidèles sont parfois solidement formés, et c’est heureux !) Lisons-le : « Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon. » Sans être juriste, on comprend aisément que l’on parle de la « réputation » de la personne qui doit être au-dessus de tout soupçon. Admettons avec le latin, qui seul fait foi canoniquement, qu’il s’agit d’être « integrae famae et omni suspicione maiores », intègre quant à la réputation et quant à des soupçons sur des affaires importantes. Il est bien noté qu’il s’agit de la réputation.
Autrement dit, on ne juge pas de la personne, mais de sa « fama », notion bien connue et des juristes et des latinistes. Varron, le célèbre magistrat et savant latin du IIe siècle, nous a appris que le mot latin fama dérive du verbe fari, dire. La fama porte donc bien sur ce qui se dit à propos de quelqu’un. Fama fut aussi le nom d’une déesse, crainte et respectée car ses yeux et ses oreilles multiples la tenaient alertée de tout ce qui se passait. On en trouve encore aujourd’hui les statues munies d’une trompe, les fameuses « trompettes de la renommée ».
Quand le droit canon parle donc de la réputation, il ne cherche pas à établir la droiture morale de la personne ni à la requérir pour que puisse être occupée telle ou telle fonction dans un diocèse (ainsi des juges, de l’évêque, du clergé, en général, selon le can. 1029, sur lequel on reviendra pour finir). Que l’archevêque de Toulouse possède l’intime conviction que monsieur l’Abbé Spina soit aujourd’hui un prêtre sûr et que sa situation de chancelier l’écarte des enfants n’est ici pas pertinent.
Pas une rumeur
Le droit canonique ne juge pas de la conscience (le fameux for interne), il statue sur les conditions publiques de l’exercice d’une fonction, discrète mais sensible. On m’objectera, comme le fait le communiqué de presse, qu’il y a des rumeurs. Elle est la voisine de la réputation par son côté sombre, l’infamie, de la même racine latine. Ici, il n’est pas question de rumeur : le jugement a été rendu, confirmé en appel, la peine purgée.
Si chacun est libre de penser que l’abbé Spina est sûr en réalité, personne ne peut dire publiquement qu’il ne l’est pas (cela pourrait constituer une diffamation, répréhensible en droit, comme dans l’Église, selon les can. 220 et 1390). En revanche, et c’est à ce genre de distinction que sert le droit, pour prendre des décisions éclairées, la réputation de monsieur l’Abbé Spina n’est plus intègre, synonyme « intacte ».
Autrement dit, son casier judiciaire n’est pas vierge, et cela « pour des délits graves », comme le précise le droit canonique au cas où un clerc agresse un enfant. On peut donc conclure que l’argument central de défense du communiqué de presse n’est pas pertinent, qu’il confond le jugement d’estime moral sur la personne (matière délicate s’il en est) avec l’évaluation d’une réputation qui a été ternie (euphémisme) par la commission d’un acte grave. La sanction donnée et la peine accomplie ne rétablissent pas la réputation, au sens où celle-ci ne préjuge pas de l’avenir mais enregistre simplement ce qui a été. Il faudrait une amnistie pour que soit effacée la mémoire infamante, ce que n’est pas le pardon, et à quoi l’amnistie ne parvient jamais tout à fait (on le voit dans les réactions autour de l’Affaire Dreyfus encore aujourd’hui). Il faut donc ajouter aussi que la nomination du chancelier n’est pas valide, peut-être même n’est-elle pas licite, mais là il faudrait des canonistes pour m’éclairer.
Un témoignage
J’ajoute une note personnelle, que le lecteur me pardonnera. Il y a quarante ans, à Verdun, le prêtre qui m’a agressé à de multiples reprises, et qui a fait des centaines d’autres victimes, était archiviste du diocèse. À la fin des années 1970, cette décision de l’évêque d’alors de retirer de toute charge pastorale un prêtre dont la réputation de pédocriminel était déjà largement établie était un acte inhabituel. Comme me l’a dit lors de l’enquête canonique un prêtre du diocèse enquêteur : « On pensait que cela suffisait, qu’on l’avait à l’œil ! » Évidemment non, puisque ce prêtre pouvait encore venir célébrer et passer de temps en temps le dimanche dans des paroisses où ses confrères, en toute bonne foi, je peux vous l’assurer, le laissaient célébrer et se trouver seul avec des enfants dans la sacristie avant la messe.
La suite, j’en vis toujours les conséquences, ainsi que ceux qui ont survécu à ses agressions (près de 500, estime le juge d’instruction). Je conclus donc avec un dernier canon, le 1029, qui dispose que le jugement de l’évêque doit être « prudent ». Là encore, vous m’excuserez de renvoyer au latin comme à la tradition théologique thomiste la plus solide aide : la prudence est la vertu par laquelle on prend une décision en ayant établi les bons critères, selon la raison et l’Esprit. Il semble pour le moins que la décision de l’archevêque de Toulouse ne le soit guère, sans rien dire du contexte actuel de cette décision, circonstance dont un jugement prudent doit nécessairement tenir compte : l’abbé Spina était à Betharram quand trois autres prêtres agressaient tant d’enfants (200 victimes ont porté plainte auprès du procureur à l’heure actuelle). Je me demande vraiment par quelle magie l’archevêque de Toulouse peut être si assuré de la réputation de son clerc ?