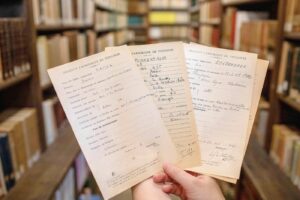Chaque nuit, des millions de lampadaires s’allument dans les rues de nos villes. Si cette lumière artificielle rassure et guide les humains, elle dérègle profondément les cycles naturels de la faune et de la flore. Pour tenter de résoudre cette équation, une équipe de recherche interdisciplinaire a conduit une expérimentation grandeur nature en Occitanie. Objectif : identifier les modalités d’un éclairage public plus respectueux de la biodiversité sans sacrifier les usages humains. Un défi d’actualité à l’heure où la pollution lumineuse devient un enjeu de santé publique et écologique.
Une expérimentation inédite au cœur de l’Occitanie
C’est à Ramonville-Saint-Agne, dans la métropole toulousaine, qu’une série de tests a été menée entre 2022 et 2023. L’étude, coordonnée par l’Inrae et impliquant des chercheurs de plusieurs disciplines (écologie, sociologie, informatique, etc.), s’inscrit dans le projet SustainLight. Ce dernier vise à concevoir un éclairage urbain durable, fondé sur des preuves scientifiques.
Le protocole mis en œuvre est ambitieux :
Ce protocole a été testé pour la première fois en 2022-2023 à Ramonville-Saint-Agne (31) où nous avons étudié pendant un an l’impact de plusieurs dispositifs d’éclairage publics sur les insectes volants, les chauves-souris, les oiseaux, la flore, ainsi que sur le ressenti et les usages des habitants », expliquent les auteurs.
Une démarche globale, qui ne sépare pas l’écologie des usages sociaux.
Une lumière moins agressive pour les écosystèmes
Les premiers résultats montrent que tous les dispositifs lumineux ne se valent pas en termes d’impact. L’intensité, la couleur, la direction ou encore le rythme d’éclairage peuvent fortement influencer les comportements des espèces animales. Par exemple, certains types d’éclairage attirent ou repoussent les insectes, perturbent les trajectoires de vol des chauves-souris ou désynchronisent les cycles biologiques des plantes.
Une approche fine est donc nécessaire :
Tous les dispositifs d’éclairage étudiés ne se valent pas. Il est possible de mieux concilier besoins de biodiversité et besoins humains grâce à une meilleure conception et gestion de l’éclairage public. »
Les habitants prêts au changement
Contrairement à certaines idées reçues, les usagers ne sont pas forcément réticents à une réduction ou une adaptation de l’éclairage. L’étude montre que les habitants sont sensibles à la question environnementale et réceptifs aux dispositifs innovants, à condition d’être bien informés. La sécurité perçue et le confort peuvent être maintenus, voire améliorés, si les aménagements sont bien pensés.
Ce constat ouvre la voie à une transition éclairée, au sens propre comme au figuré. Car l’éclairage public, bien qu’indispensable, peut évoluer vers des formes plus intelligentes et plus respectueuses du vivant. Le projet SustainLight insiste alors sur la nécessité d’impliquer les citoyens dans les choix techniques, via la concertation ou la pédagogie.
Un guide pour les collectivités
Forts de ces résultats, les chercheurs souhaitent désormais accompagner les collectivités locales dans la transformation de leurs politiques d’éclairage. Une plateforme d’outils en libre accès, alimentée par les données du projet, est mise à disposition : sustainlight.sk8.inrae.fr.
L’idée est de proposer des recommandations concrètes, contextualisées et fondées sur des preuves :
Le projet SustainLight entend proposer une méthode d’évaluation et de conception de l’éclairage public fondée sur des preuves scientifiques pour concilier sobriété énergétique, qualité de vie et préservation de la biodiversité. »
Alors que de nombreuses communes s’interrogent sur leur consommation énergétique et leur empreinte écologique, cette initiative tombe à point nommé, démontrant qu’il est possible d’allier sobriété et modernité, nature et sécurité, science et usage quotidien.
>> À LIRE AUSSI : Cinq talents d’Occitanie sacrés par le CNRS : science, engagement et innovation au rendez-vous