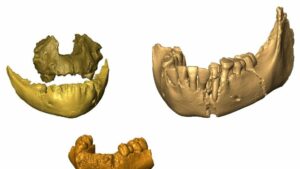« H ». « H comme Hirtmann ». Autrement dit le retour de Martin Servaz et de son « meilleur ennemi ». Mais le commandant de police de Toulouse n’est plus seul à ses trousses. Bernard Minier, l’écrivain aux 8 millions de livres vendus, nous propose le 9ème volet des enquêtes de son flic fétiche et affirme son soutien au développement du livre en braille.
« Hirtmann est à vos trousses, commandant. Il n’est pas loin. Il est tout prêt. Vous ne le voyez pas, mais lui vous voit. Il attend son heure. La question, c’est : pour quoi faire ? Quelles sont ses intentions ? Pourquoi est-il revenu ? » (Extrait de H)
Il est suspecté du rapt et du meurtre d’une quarantaine de femmes. Julian Hirtmann s’est évadé d’une prison en Autriche et il est suspecté d’être de retour dans les environs de Toulouse. Martin Servaz et sa famille sont placés sous protection.
Les temps changent, commandant …
Les nuits du commandant de police judiciaire ne seront plus calmes. Et le métier a évolué. « Les temps changent, commandant, les choses qui étaient permises naguère ne le sont plus aujourd’hui, les anciennes idoles sont abattues. On fait place nette, on assainit, on hygiénise, » lui lance son supérieur.
La région est de nouveau le théâtre de crimes. Qui enlève et tue les filles aujourd’hui ? Il faut retrouver Julian Hirtmann, le plus célèbre des tueurs en série, s’il en est bien l’auteur…
Mais Martin Servaz n’est pas le seul à enquêter. Il doit composer avec un écrivain en quête de gloire, une journaliste, dont un confrère s’est suicidé alors qu’il enquêtait sur des disparitions, un club de détectives amateurs sur internet, les « web sleuthers » et un présentateur vedette d’un célèbre talk-show Tv prêt à tout pour interviewer Hirtmann. Il faut démêler le vrai du faux. Le chaos et la terreur s’installent.
Avec H, Bernard Minier nous propose un 9ème volet des aventures de Martin Servaz aux multiples rebondissements, toujours aussi captivant et angoissant.
Né à Béziers, il a vécu son adolescence à Montréjeau dans le Comminges, au pied des Pyrénées puis a étudié à Toulouse et Tarbes. À 50 ans, il publie son premier roman « Glacé », en 2011. Traduit en 28 langues, Bernard Minier est l’un des auteurs de thrillers les plus lus en Europe. Il a vendu 6,6 millions d’exemplaires en France et déjà 1,5 million d’exemplaires à l’étranger. H est son 13ème roman.
Martin Servaz est de retour deux ans après Un œil dans la nuit. Qui entretient cette flamme ? Est-ce que c’est vous ou le lecteur ?
Je pense que c’est un peu les deux. Moi, j’aime bien maintenant ce rythme où l’on retrouve Martin une année sur deux. Tous les ans, ça ferait peut-être beaucoup.
Et je sais que mes lectrices et mes lecteurs ont besoin de Martin Servaz. Je les verrais mal se passer de Martin Servaz pendant un certain temps. Mais j’aime bien l’idée d’alterner entre lui et ma nouvelle guerrière, entre guillemets, Lucia Guerrero, la policière espagnole.
Servaz semble de plus en plus tourmenté. Comment faites-vous évoluer votre personnage ?
Je ne pense pas qu’il soit plus tourmenté qu’au début. Et au contraire, je pense qu’il était peut-être encore plus fragile.
Je pense qu’il est plus désabusé aujourd’hui. Il est plus désespéré peut-être aussi parce que beaucoup de policiers en fin de carrière ont l’impression de vider l’océan à la petite cuillère. Et c’est une lutte sans fin : la lutte contre la criminalité, contre les trafics, contre la délinquance, contre la violence au quotidien. C’est quelque chose qui forcément vous use.
Vous dîtes : « Le truc le plus intéressant pour moi, ce sont les personnages ». Pourquoi ?
Bien sûr. Parce que tout simplement, il n’y a pas de bonne histoire sans bon personnage. Ça n’existe pas. Vous pouvez avoir l’intrigue la plus astucieuse du monde avec un twist extraordinaire à la fin, avec des rebondissements partout, si vous n’avez pas les personnages qui tiennent la route, votre récit, il sera sans intérêt.
Je vous mets au défi de me raconter l’intrigue de pas mal de romans policiers. Ce sont les personnages. C’est Sherlock Holmes, c’est Lisbeth Salander (Millénium), c’est Kurt Wallander de Henning Mankell, c’est Smiley de John le Carré, c’est Maigret.
Vous pouvez avoir l’intrigue la plus astucieuse du monde avec un twist extraordinaire à la fin, avec des rebondissements partout, si vous n’avez pas les personnages qui tiennent la route, votre récit, il sera sans intérêt.
Et puis, je l’ai souvent dit, on peut avoir un roman avec une intrigue, disons, squelettique. Celle de Millenium, par exemple. En fait, si vous en faites un résumé, ça tient une demi-page. Mais à condition qu’on ait de très bons personnages. Parce que le personnage, c’est la vie. Parce que la matière de tout romancier, qu’il soit de genre ou pas, c’est l’humain.
La littérature s’intéresse aux individus pris aussi bien dans leur existence sociale que dans leur vie intime la plus secrète. C’est ça, le cœur du réacteur.
La phase préparatoire est très importante pour vous. Avec de l’immersion par exemple. Est-ce que c’est votre définition de l’écrivain du réel ?
Oui, tout à fait. Je suis un écrivain réaliste. Donc qui dit réaliste, dit bien informé. Vous savez, Milan Kundera disait que l’esprit du roman, c’est l’esprit de complexité : « les choses sont plus compliquées que tu ne le penses ». C’est une phrase que j’ai répétée plein de fois. Mais on ne peut pas montrer cette complexité si on ne sait pas de quoi on parle.
Moi, il y a une chose que je n’arrive pas à comprendre, et je sais que ça existe. Ce sont les écrivains qui situent des intrigues dans des pays où ils n’ont jamais mis un orteil. Alors ça, ça me dépasse complètement.
Quand on reste à la surface des choses, quand on est ignorant de la réalité, on tombe dans le cliché, dans le stéréotype… Donc pour rendre compte de ce caractère multiforme et contradictoire du réel, il faut travailler, il faut suer un peu, il faut mouiller la chemise, il faut aller au contact, il faut se rendre sur place.
Moi, il y a une chose que je n’arrive pas à comprendre, et je sais que ça existe. Ce sont les écrivains qui situent des intrigues dans des pays où ils n’ont jamais mis un orteil. Alors ça, ça me dépasse complètement.
Déjà, quand vous y allez, il ne faut pas y aller en touriste. Moi, quand j’ai été à Hong Kong (NDLR / pour M, le bord de l’abîme ), j’ai exploré Hong Kong de nuit, et de jour. Mais j’ai surtout été dans les quartiers où les touristes ne vont pas, au contact de la population. Ce n’est pas parce qu’on écrit des thrillers ou de la littérature de genre qui est aussi quelque part un divertissement qu’on n’a pas cette responsabilité de savoir de quoi on parle.
Couverture du dernier livre de Bernard Minier « H » • © XO Editions
C’est aussi pour ça que vous évoquez beaucoup et vous positionnez vos histoires régulièrement dans les Pyrénées ?
Oui. Effectivement, c’est beaucoup plus facile. J’ai passé 17 premières années de ma vie à Montréjeau aux pieds des Pyrénées. Donc c’est une géographie que je connais très bien, même si elle évolue, elle aussi. Ce décor est merveilleux. Pour un auteur de polar, c’est un décor, c’est une ambiance absolument extraordinaire.
Moi, vous savez, j’aime bien les auteurs qui ont leur territoire. Et donc moi, j’ai aussi mon territoire.
Vous travaillez donc beaucoup en immersion. Pour un prochain livre, ce sera autour du métier de juge d’instruction ?
Je ne sais pas si ça sera le prochain ou le suivant, parce que ma réflexion est en train d’évoluer. Mais que ce soit le prochain avec ce juge d’instruction, de toute façon, si ce n’est pas l’année prochaine, ça sera l’année suivante, parce que j’ai déjà plein d’éléments.
Si c’est avec Lucia Guerrero, à ce moment-là, je vais retourner en Espagne rencontrer les enquêteurs de l’unité centrale opérationnelle, le service de Lucia. De toute façon, d’ici un mois, je vais être en immersion, c’est sûr.
Vous parlez aussi de la phase de réécriture qui est tout aussi importante pour vous que la phase préparatoire. Comment cela se caractérise ?
Il y a plusieurs phases de réécriture. Il y a déjà ma propre réécriture, c’est-à-dire que tous les matins, quand je me lève au petit-déjeuner, la première chose que je fais, c’est de relire les pages que j’ai écrites la veille. Ensuite, il y a une réécriture plus globale.
Et puis j’aime bien retravailler le texte, j’aime bien ce polissage en quelque sorte du texte, le faire mûrir, le faire progresser. Dans un temps assez court finalement, ce qui n’est pas toujours la meilleure des choses, mais c’est comme ça. Donc oui, il y a le premier jet, je crois que c’est Fred Vargas qui disait que « le premier jet c’est toujours de la merde ».
Moi je réécris au fur et à mesure, si le premier jet n’est pas forcément si mauvais que ça, mais il est toujours perfectible.
Dans H, Martin Servaz n’est plus seul dans la chasse à l’homme, pour retrouver Hirtmann. Vous mettez en avant des groupes d’enquêteurs amateurs, un écrivain, un présentateur TV très, très connu. Tout ça évoque donc la true crime et toutes ses dérives. Que pensez-vous de ce phénomène de true crime, justement ?
Il me laisse perplexe. Il y a toujours eu un intérêt pour les faits divers. Avant même que je naisse, il y avait l’affaire Dominici qui avait défrayé la chronique en France et qui faisait l’une des journaux tous les jours. Après, il y a eu l’affaire Bruay-en-Artois, l’affaire du petit Grégory, et ainsi de suite. Enfin, ça a toujours existé.
Il y avait des magazines spécialisés. Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que tout le monde, ou presque, regarde du true crime. Ou écoute du true crime, puisque ça existe en France aussi. Vous en avez sur les plateformes de streaming, vous en avez dans les magazines, vous en avez absolument partout. Et je connais très peu de gens autour de moi que le phénomène ne fascine pas. Et je me demande pourquoi.
Qu’est-ce qui nous attire chez ces criminels ? Qu’est-ce qui nous fascine chez eux ?
Qu’est-ce que ça dit de nous, tout ça ? Quand on lit un roman policier, on sait qu’on lit une fiction. Quand on regarde un true crime, justement, par définition, c’est du crime réel, des criminels existants. Qu’est-ce qui nous attire chez ces criminels ? Qu’est-ce qui nous fascine chez eux ?
Il y a un phénomène qui est encore plus stupéfiant. C’est les tueurs en série, mais aussi la plupart des grands criminels qui reçoivent des centaines de lettres de femmes qui sont des groupies.
En France, c’est le cas de Patrice Allègre Mais qu’est-ce qui attire ces femmes ? Qu’est-ce qu’elles recherchent ? Il faut savoir aussi que 75% des auditeurs de podcasts de true crime sont des auditrices. On n’arrête pas de rappeler que la violence est un phénomène essentiellement masculin, mais la fascination pour la violence n’est pas un phénomène masculin.
En quoi la violence peut-elle, c’est le point fascinant,et la monstruosité même, peuvent-elles attirer ? Je ne sais pas. Moi, je ne trouve rien d’attirant à la monstruosité, même si j’ai des monstres dans mes livres.
Le Centre National du Livre dit que la lecture est menacée. Quelle est votre réaction ?
Je ne sais pas si la lecture est menacée. Moi, j’étais au salon du Livre à Paris. À 8h30 du matin, il y avait une file d’attente qui était absolument incroyable. Les premières semaines de H, par exemple, on a fait + 10% par rapport à l’année d’avant. Donc on est plutôt en progression qu’en recul.
Est-ce que les gens vont cesser de lire ? Je ne crois pas, non.
Après, oui, il paraît que la lecture recule. Mais regardez les jeunes avec la romance qui se tournent de nouveau vers la lecture. Beaucoup de gens critiquent la romance, mais en attendant, ça les fait lire. C’est naturel quelque part que la lecture recule parce qu’elle est concurrencée par de plus en plus d’autres sources d’informations et de divertissements, les séries télé, les films, les plateformes de streaming, les podcasts, les chaînes YouTube, etc.
Tout ça, moi, quand j’étais adolescent, ça n’existait absolument pas. Donc tout ce qu’on avait, c’était la lecture. Donc il est normal qu’à un moment donné, la lecture diminue. Est-ce que les gens vont cesser de lire ? Je ne crois pas, non. Non, je ne pense pas. Je pense qu’il y aura toujours des populations qui vont vouloir lire.
Lecture d’un livre en braille • © LIONEL BONAVENTURE / AFP
Vous êtes le parrain du CTEB à Toulouse qui favorise l’accès aux livres en braille. Pourquoi avoir accepté de devenir parrain de cette structure ? Et quel est votre rôle ?
J’ai accepté bien volontiers parce que ça a du sens puisqu’on parle de lecture, justement, qu’on vient d’évoquer à l’instant. On parle de texte. Donc soutenir la lecture, y compris la lecture en braille, ça me paraissait une bonne chose. Et mon rôle, il est tout petit. J’essaie de leur donner un peu de visibilité à mon niveau.
Alors tout ça, c’est formidable. Mais le but, c’est quand même d’avoir de la part du ministère de la Culture et du Centre national du livre un véritable soutien financier parce que pour l’instant, il n’y est pas. Les aides sont très très très faibles, dérisoires même.
Le but, c’est quand même d’avoir de la part du ministère de la Culture et du Centre national du livre, un véritable soutien financier parce que pour l’instant, il n’y est pas. Les aides sont très très très faibles, dérisoires même.
Et aussi, avec le Centre national du livre, on voulait revoir les critères d’attribution des aides aux associations. Alors, madame la ministre Rachida Dati explique qu’il y a un grand portail numérique qui est en train de se préparer pour les malvoyants et les non-voyants. C’est très bien comme initiative.
Sauf que ça ne résout pas le problème du braille. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas forcément très douées avec les outils numériques. Il y a plein de domaines comme ça où on est en train d’exclure tout un pan de la population parce qu’il faut tout faire par internet. Bientôt, on n’aura plus le choix. Il n’y aura plus de papier.
Le braille est encore lu par des dizaines de milliers de personnes en France. Donc j’ai vu Mme Dati, j’ai vu sa directrice de cabinet au mois de janvier, j’ai vu le directeur du Centre national du livre. Et j’attends les résultats, parce qu’ils m’avaient promis qu’ils reviendraient vers moi rapidement. Je vais les relancer. Mais bon, c’est compliqué.
Alors H, votre dernier ouvrage est sorti en braille. Est-ce que c’est difficile de proposer un livre en braille ? Je crois qu’il y a des coûts qui sont extrêmement importants.
Le CTEB fait un travail extraordinaire. Les livres en braille coûtent beaucoup plus cher à fabriquer. Ils sont vendus au prix unique du livre. C’est la volonté. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu’à chaque livre vendu, ils perdent de l’argent. Plus ils vendent de livres, plus ils perdent d’argent. Donc évidemment, il faut des fonds, il faut des aides. Chacun peut contribuer aussi via le site internet de l’association.
Le CTEB, le centre de transcription et édition en braille, a besoin d’être financé parce que sinon, les livres seront à des prix que personne ne pourrait s’offrir. Or, le but, c’est un accès égal à la lecture pour tous, un accès égal à la culture pour tous. Voilà. C’est de ne pas exclure toute cette frange de la population. 50% des malvoyants en France et des non-voyants sont au chômage.
Le CTEB, le centre de transcription et édition en braille, a besoin d’être financé parce que sinon, les livres seront à des prix que personne ne pourrait s’offrir. Or, le but, c’est un accès égal à la lecture pour tous, un accès égal à la culture pour tous.
Donc on ne va pas les exclure encore un peu plus. Et beaucoup continuent à lire le braille parce que le braille, c’est le texte intégral. Ce n’est pas le livre audio. C’est le texte intégral avec les points, les virgules, avec les italiques. Le braille, c’est aussi l’apprentissage de l’orthographe, de l’écriture. C’est plein d’autres choses.
Le livre audio, c’est bien, mais c’est une adaptation. Ce n’est pas le texte.
Donc qu’est-ce qu’il faudrait faire ? S’il y avait une ou deux démarches à faire ou choses à faire ou que vous demanderiez aux collectivités ?
Il faut revoir les critères d’attribution des aides. Ce en quoi, d’ailleurs, le directeur du Centre national du livre que j’ai rencontré est d’accord. Mais là, il faut que ça bouge. Il faut organiser un groupe de travail. Mais sinon, il a reconnu lui-même qu’il fallait revoir les critères d’attribution des aides. Donc ça, c’est une première chose.
La deuxième chose, c’est que le CTEB qui fait un travail extraordinaire avec peu de moyens, c’est 10 salariés et 40 bénévoles, touche royalement du ministère de la Culture 20 000 € par an. Parallèlement, le portail numérique pour les non-voyants et les malvoyants va coûter plusieurs millions d’euros.
On ne leur demande pas des millions d’euros. 200 000 €, ça équilibrerait leur budget pour une année au lieu d’être obligé de chercher à droite et à gauche.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse
/regions/2025/04/16/h-cv-67ffb9bb755dc603562564.jpg)
/regions/2025/04/16/000-336f9tq-67ffbc5d4996f608727754.jpg)