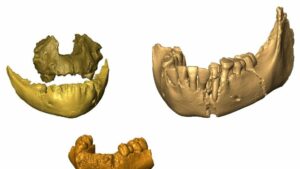Étienne Blanc, Sénateur du Rhône, co-auteur de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic anime, ce jeudi, au centre de congrès Pierre Baudis, une conférence sur le thème » Narcotrafic : nos villes et métropoles face à la criminalité organisée « . Il fait un constat sans concession de la situation et alerte sur l’urgence à agir.
Comment expliquez-vous que les institutions judiciaires et policières ont mis tant de temps à apprécier l’ampleur du phénomène du narcotrafic en France ?
Pendant longtemps, la question de la drogue n’a pas été prise au sérieux en France, pour des raisons culturelles notamment. Il existait une forme de tolérance, presque de fascination, à l’égard de la consommation : le trader qui prend un rail de coke, l’artiste ou l’acteur qui fume un joint… La consommation de drogue était perçue comme un fait individuel, sans gravité, et le phénomène du narcotrafic a été cantonné à quelques quartiers dits “sensibles”, comme s’il n’impactait pas le reste du pays. Cette vision réductrice a conduit à un sous-investissement chronique, une fragmentation des réponses institutionnelles, un déficit de coordination, et une législation inadaptée face à des réseaux criminels toujours plus puissants et structurés. Tout l’enjeu du rapport sénatorial que j’ai eu l’honneur de porter avec mon collègue sénateur socialiste Jérôme Durain, c’était justement de mettre en lumière ce véritable tsunami blanc qui déferle aujourd’hui sur notre pays.

Ne s’est-on pas trop accommodé, pendant des années, de cette économie parallèle qui tenait l’équilibre des quartiers, et garantissait la paix sociale ?
Il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître : pendant des années, certains ont fermé les yeux sur l’existence d’une économie parallèle dans les quartiers, au motif qu’elle garantissait une forme de paix sociale. Le trafic de drogue jouait un rôle d’amortisseur, permettant à des jeunes d’avoir des revenus, à des territoires de tenir debout. Cette forme de compromis tacite a nourri une dangereuse illusion de stabilité. Mais à quel prix ? Celui de la perte d’autorité de l’État, de la banalisation de la violence, et de la montée en puissance de véritables empires criminels. Le rapport sénatorial l’a clairement établi : aujourd’hui en France, ce sont près de 240 000 personnes qui vivent directement ou indirectement du narcotrafic. C’est un chiffre vertigineux, qui dit l’ampleur de l’emprise. On a laissé s’installer une souveraineté concurrente fondée sur l’argent sale et l’intimidation. Ce système parallèle n’a pas apporté la paix : il a installé le chaos.
On a assisté à des opérations très médiatisées (et peu efficaces) sur le nettoyage des points de deal qui se reconstituent invariablement ailleurs, la « guerre » n’est-elle pas perdue d’avance ?
Il est vrai que les opérations “place nette” ont parfois un effet temporaire, avec un déplacement des trafics vers d’autres quartiers. C’est un phénomène bien connu, mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras ou renoncer à agir. Ces interventions ont été utiles pour soutenir les habitants à qui cela a offert un répit, même de courte durée. Cependant, il ne faut pas se contenter de la seule réponse ponctuelle : il faut accompagner ces opérations par un réarmement de l’État, par de réels moyens donnés aux forces de l’ordre et à la justice. C’est tout l’objet de la proposition de loi qui a été votée à l’unanimité au Sénat et à une très large majorité à l’Assemblée nationale, et qui vise à donner enfin à la puissance publique les moyens d’obtenir des résultats durables dans la lutte contre le narcotrafic.
« La légalisation totale des drogues ne résoudra pas le problème »
Quelles sont selon vous les politiques à mettre en œuvre pour tenter d’enrayer un commerce mondialisé qui reste le plus lucratif avec le trafic d’armes ?
La mondialisation du narcotrafic appelle à une coopération internationale puissante. Europol et Eurojust sont efficaces mais l’importance du crime appelle à leur donner plus de puissance. De même, la coopération avec les États-Unis, l’Amérique du Sud ou l’Afrique doit s’amplifier. Si l’on prend l’exemple des Caraïbes, cette coopération est la matrice d’une politique efficace. Le développement du renseignement et celui des techniques spéciales d’enquête constitue aussi un outil déterminant. À cet égard, on peut regretter que le système des portes dérobées qui permettent de pénétrer les réseaux d’informations cryptées ait été écarté sous prétexte de protection des libertés individuelles. Ce faisant, nous avons privé la puissance publique de moyens très efficaces. Enfin, c’est la saisie des avoirs criminels, sur l’ensemble de la planète, dans le cadre de coopérations poussées là où se sont réfugiés les narcotrafiquants qui fera le plus de mal au réseau criminel. Sur tous ces sujets nous pouvons faire beaucoup mieux.
Places nettes et prisons de haute sécurité sont-elles des réponses pertinentes ?
La construction de prisons de haute sécurité représente une réponse importante dans la lutte contre le narcotrafic, en particulier pour isoler les criminels les plus dangereux et empêcher la continuité de leurs activités depuis l’intérieur des établissements pénitentiaires. Le rapport sénatorial a souligné les nombreuses difficultés logistiques auxquelles sont confrontées nos prisons actuelles, souvent surpeuplées et insuffisamment équipées pour gérer ces détenus à très haut risque. Ce dispositif s’inspire du “carcere duro”, un système italien qui a fait ses preuves dans la lutte contre la mafia en coupant les liens entre les chefs criminels incarcérés et leurs réseaux extérieurs. Toutefois, il faut garder à l’esprit que ces prisons ne sont qu’un maillon d’une stratégie globale, car l’efficacité passe aussi par une meilleure prévention, une coordination accrue des forces de l’ordre, et une coopération internationale renforcée.
Historiquement, pour l’alcool ou le tabac comme pour la drogue, la prohibition a engendré les trafics et l’enrichissement des mafias, ne serait-il pas plus simple de légaliser toutes les drogues ?
La légalisation totale des drogues, loin de résoudre le problème, risque au contraire de renforcer le pouvoir des mafias. En effet, en cas de marché légal, ces réseaux continueraient à exister et chercheraient à prendre le contrôle du marché officiel, comme on l’a déjà vu avec le tabac où la contrebande prospère malgré un commerce très régulé. De plus, le cannabis vendu aujourd’hui dans la rue présente souvent des taux de THC très élevés, ce qui pose des risques sanitaires importants. Pour des raisons de santé publique évidentes, l’État ne pourra s’aligner sur ces taux et les consommateurs préféreront mécaniquement une drogue produisant plus d’effets sur eux. En outre, un marché légal, soumis aux taxes, verrait mécaniquement ses prix plus élevés, ce qui laisserait un marché parallèle florissant, car les trafiquants pourraient proposer des produits moins chers, échappant à la fiscalité. C’est un cercle vicieux. Par ailleurs, les pays qui ont légalisé certaines drogues sont loin d’afficher des résultats probants et nombreux d’entre eux réfléchissent aujourd’hui à rétropédaler. C’est pourquoi il est beaucoup plus important de mener des politiques de communication fortes, sur le modèle de celles qui ont réussi à réduire la consommation d’alcool ou de tabac, en informant clairement sur les risques. La priorité doit être donnée à la prévention, à la répression ciblée des réseaux criminels, et à l’accompagnement sanitaire, plutôt qu’à une légalisation aux effets incertains et potentiellement dangereux. C’est ce que nous avons dit dans notre rapport.