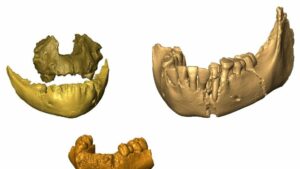Des psychologues de l’Oncopole de Toulouse (Haute-Garonne) ont créé des podcasts qui questionnent les injonctions autour du cancer. Cette série « Vulnérables mais pas coupables » est là pour soutenir les femmes qui trop souvent se culpabilisent de ne pas adopter « la bonne attitude » face à la maladie. Alors que la société et même leurs proches les enjoignent à se battre, à « être positives ».
En étant proche de personnes atteintes d’un cancer, on ne sait pas forcément que dire pour leur marquer notre soutien. Et les mots qui viennent spontanément sont souvent des formules qui se veulent encourageantes comme « Allez, faut que tu gardes le moral »; « Courage, tu vas la battre cette maladie, t’es une guerrière » ou encore « Le moral, c’est 50 % de la guérison »… Ces paroles et d’autres injonctions sociétales ont pour effet, souvent, de culpabiliser les malades et particulièrement les femmes.
Des psychologues de l’Oncopole : Luce Domingo, Jonathan Grondin et Mandy Simoes, frappés de constater cette culpabilité chez la plupart des patientes ont créé une série de podcasts à leur intention. « Vulnérables mais pas coupables » s’adresse à elles mais aussi à leurs proches et à l’ensemble des citoyens car la question englobe des enjeux majeurs pour notre société.
France 3 : Pourquoi ce projet ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : il est parti de notre expérience clinique. On se rendait compte que les malades avaient toutes et tous le même discours, plus précisément les femmes. Elles supposaient que leurs capacités psychiques pouvaient avoir une incidence sur les traitements et, in fine, sur la guérison. Elles pensaient que leur attitude psychologique, si elles étaient suffisamment positives, guerrières, serait déterminante.
On psychologise le cancer, on réduit une maladie complexe à des causes psychologiques, (par exemple une séparation, un burn-out, etc.) qui seraient censées expliquer le cancer. Et cette explication, pour nous, elle défigure la réalité puisque c’est une maladie qui fait système presque. D’après de très nombreuses études, il n’y a pas de liens entre stress et cancer, pourtant c’est un discours qui est omniprésent. Plutôt que d’interroger le système, on vient interroger la vie individuelle de la personne : « parce que dans ta vie, il a dû se passer quelque chose ».
On a des personnes qui rentrent dans un processus de faire 4 ou 5 thérapies à côté pour se dire « il faut que je fasse ci, il faut que je traite tel trauma », etc. Elles se mettent une énorme pression psychique parce qu’elles sont persuadées de s’être causé leur cancer. Donc, c’est une profonde culpabilité, une honte. On a même des gens qui ont honte, qui se sont dit : « quelle vie j’ai eue pour avoir ce cancer ? ».
Autre exemple sur cette combativité que les malades s’imposent : il y a quelque temps, j’ai une jeune femme de 28 ans qui a eu un cancer du sein. Elle a été combative tout au long de ses traitements. Malheureusement, 6 mois après, elle a récidivé. Et elle me disait que le fait d’être dans cette posture combative, ça a généré une tension monstrueuse. C’était insupportable puisque ça l’oppressait elle-même. Paradoxalement, la récidive l’a soulagée, parce qu’en fait, elle s’est rendu compte que le cancer se moque bien de son attitude face à la maladie.
France 3 : Cette combativité peut finir par être un piège ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Ces injonctions-là de combativité ou de positivité, elles sont très séduisantes. Mais vu que le cancer est une maladie de longue durée, elles s’avèrent, au fur et à mesure du temps, assez délétères. Et puis peut-être que ça viendrait à dire de celles qui n’en guérissent pas, qu’elles l’ont mérité.
Les patientes s’attribuent ou elles attribuent à leur mode de vie le fait de guérir ou pas, et même le fait d’être tombées malades. Il y a une culpabilité qui les rassemble, en fait. Ces injonctions n’interviennent pas pour toutes les maladies, mais seulement pour les maladies graves.
Par exemple, on ne va jamais dire à un diabétique d’être combatif ou positif pour guérir de son diabète. Ces injonctions s’adressent plus spécifiquement aux patientes parce que les femmes sont éduquées à prendre soin des autres. Et donc pour prendre soin des autres, il faut qu’elles fonctionnent. Pour fonctionner, on va leur proposer plusieurs types d’injonctions : être positives, être combattantes, dans un contexte où elles sont grandement vulnérables.
On leur propose toutes ces injonctions pour qu’elles continuent à maintenir l’ordre familial, à maintenir les activités au sein de la famille, emmener les enfants chez le médecin, les préparer pour l’école, mettre le linge dans la machine à laver, accomplir toutes les tâches ménagères, congeler les repas parce qu’elle va faire sa chimio… Bref tout ce qui fait que ça fonctionne. Pour que la famille continue à se reposer sur la femme, en fait.
France 3 : Vous avez des exemples de cette invisibilité des femmes et de tout ce qu’elles font, de tout ce qu’elles donnent ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Oui, par exemple, là, j’ai eu le mari d’une femme dont la dame va certainement mourir. Et il est submergé par toutes ces tâches qui sont invisibles pour l’homme. Il pensait que son linge était propre comme par magie et que le fonctionnement du logis se faisait de manière presque magique. C’est vous dire à quel point il y a une invisibilisation du travail domestique qu’accomplissent les femmes.
Il y a les travaux d’Anastasia Meidani qui est sociologue et aussi de Mounia El Kotni, une anthropologue de la santé. Elles disent que ces injonctions d’être des guerrières, ça permet aux femmes de s’orienter dans cet épisode catastrophique qu’est la maladie pour ne pas lâcher, parce que si elles lâchent, il y a tout un pan de la société qui lâche avec elle.
L’État-providence ne tient pas sans les femmes. Dans toutes les fonctions de soins, ce sont elles qui opèrent. Comme le dit Mounia El Kotni, c’est comme imaginer une grève des femmes. Eh bien l’État-providence ne tient plus, puisque tout ce qui fait soin, ce sont les femmes qui le font.
La question du « care », la question du soin, c’est le piège des femmes. Et en même temps, c’est ce qui leur permet de tenir. Il y a tout un pan qui est fait pour que les femmes malades ne soient pas perçues comme malades.
France 3 : Comment ça se traduit au-delà des injonctions ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Il y a tout un dispositif qui est mis en place pour masquer la maladie. On les invite très fortement à cacher leur crâne chauve, même si c’est peut-être un peu moins le cas avec la nouvelle génération. Le féminisme a effectué son travail. Mais on a quand même beaucoup de femmes qui vont adopter les perruques, les foulards, qui vont beaucoup se maquiller. On voit qu’elles surjouent un peu des traits de la féminité, justement parce que ça cache aux yeux des bien portants le fait qu’elles sont malades.
On constate ce phénomène aussi sur les prothèses. Il y a des prestataires qui viennent dans les chambres des patientes, après une chirurgie, pour leur proposer une prothèse. Très vite, on rentre dans ce système de la maladie qui ne doit pas se voir. La société a beaucoup de mal à regarder les personnes malades. Et, étonnamment, on ne propose pas du tout les mêmes dispositifs aux hommes.
Beaucoup de personnes qui ne sont pas malades ont pu nous dire : « il y a des trucs, j’ai pas pu écouter, c’était trop compliqué ». Alors qu’en vrai, ce qu’on dit n’est pas non plus extrêmement ou profondément triste.
On voit à quel point, pour les personnes qui ne sont pas malades, c’est quelque chose de très très compliqué d’approcher la vulnérabilité et le fait qu’à un moment donné, on peut ne plus être tout-puissant, avoir la totale maîtrise de sa vie. Donc il y a aussi cet élément-là qui joue beaucoup et qui participe à invisibiliser les femmes.
France 3 : Quel est l’impact sur elles ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : L’impact, c’est qu’elles se taisent, qu’elles se culpabilisent de ne pas être assez ceci ou de ne pas être assez cela. Et c’est terrible parce qu’en fait, déjà elles ne vont pas bien, et en plus elles doivent porter sur elles le fait que les autres aillent bien.
J’ai revu une dame cet après-midi, c’était terrible à écouter, parce qu’elle s’est emmurée dans des mensonges et des non-dits dans sa propre famille car c’est impossible pour ses proches de se confronter à cette vulnérabilité-là. J’ai même des patientes qui en viennent à quitter le domicile pour s’extraire de tout ça.
« Qu’est-ce que je dis, qu’est-ce que je ne dis pas, attention à comment je m’apprête, attention à comment je me montre, attention à ce que je dis »… C’est vraiment un épuisement de devoir toujours avoir cette prudence finalement dans la façon dont elles s’adressent aux autres, dans la façon dont elles se montrent.
France 3 : A vous entendre, elles ne peuvent pas être elles-mêmes dans ce qu’elles traversent de douloureux…
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Il y a de ça oui. Longtemps, on s’est dit que c’était bizarre que la plupart des personnes qui venaient nous voir étaient des femmes. On supposait que c’était parce qu’elles avaient plus de facilité à élaborer quelque chose de leur expérience. Mais en fait c’est que ces femmes-là, leur mari souvent n’est pas en capacité à recevoir les plaintes parce qu’il a été éduqué comme un garçon.
S’il n’y a pas le corps professionnel autour d’elles ou la mère, la cousine, la tante, l’amie, elles peuvent s’écrouler. Le soutien de ces personnes-là, va être pris en soin par les autres femmes de la famille. Toujours les femmes, qui sont dans le soin.
France 3 : La société n’a-t-elle pas évolué sur ce plan-là ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Non et ça crée quelque chose de particulier : on a beaucoup de patientes qui viennent pour se rassurer sur la normalité de leurs réactions. Elles viennent souvent nous voir parce qu’elles ont besoin de savoir que d’autres patientes disent des choses comme ça.
Ma dernière consultation, c’était une dame qui avait vraiment besoin que je lui renvoie que les moments où elle se sent moins bien, parce que son parcours de soins fait qu’il y a beaucoup d’incertitudes, c’est normal. Et moi ça m’interroge beaucoup parce que je me dis : à quel point on en est dans notre société pour en arriver à penser que face à l’angoisse de la récidive, ce n’est pas normal de pas être pas bien ?
Qu’est-ce qui se passe pour que les femmes aient besoin de nous voir pour se rassurer sur le fait que leur réaction émotionnelle soit normale face à des choses dramatiques de la vie ? C’est très questionnant. Et on a de plus en plus ce type de consultations. Et c’est construit. Ça ne vient pas au fil de l’entretien… c’est vraiment « j’ai besoin de vous voir parce que moi il m’arrive ça, je suis mal et j’ai besoin de savoir si vous avez d’autres femmes qui vivent la même chose ».
France 3 : Comment vous l’expliquez ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Il y a une volonté de se débrouiller. On est dans une société où la vulnérabilité est totalement effacée, parce qu’elle est associée à une absence de production, de productivité.
Si je suis vulnérable, on doit prendre soin de moi, donc je ne suis pas productive, etc. Donc effectivement, le lien qu’on peut faire par rapport à cette demande « Est-ce que je suis normale ? », c’est le fait qu’on apprend aux gens que, face à tout, même des choses terribles, ils doivent s’adapter, ils doivent être résilients, en faire quelque chose de positif. C’est la seule proposition dans le discours qu’on met en avant aujourd’hui.
On a des situations dramatiques. La vie de l’humanité est traversée de drames, mais maintenant ça devient des opportunités. Il faut à tout prix que ça devienne quelque chose de productif. Alors que la plupart du temps, il n’y a pas grand-chose à en faire si ce n’est de traverser.
Tout doit être une occasion de se performer et d’être encore plus surhumain. « Je vis quelque chose de terrible, il faut encore que je me surpasse », et pour se surpasser, accessoirement il faut mettre en place des choses qu’il va falloir financer.
Ça va nourrir tout un système autour, il va falloir faire de la sophro, de la socio-esthéticienne, du développement personnel, de la psycho, etc., pour gérer ces émotions qui en fait sont des émotions humaines, normales. On vient « pathologiser » des émotions standards. Mais en les « pathologisant », on crée un système économique autour de ça.
France 3 : Il y a d’ailleurs des critiques qui émergent sur la médiatisation d’Octobre Rose ?
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : Certains exemples mis en avant par les médias vont dans ce sens de l’hyper performance. Dernièrement, il y avait une jeune femme qui venait d’apprendre qu’elle avait un cancer et durant sa chimio, elle qui avait toujours voulu courir le marathon de New York, y est allée. En fait, ce genre de modèle vient écraser la plupart des femmes parce qu’elles se disent : pourquoi moi je n’y arrive pas ?
Effectivement, les relais médiatiques, ce n’est que des patientes héroïques. Des patientes qui ont réussi à transformer cet épisode adverse en quelque chose de beau, le fait de repenser sa vie, le fait de changer de travail, etc. Et ça c’est terrible parce que le fait que les médias présentent ces personnes-là comme modèles, ça vient vraiment abîmer, altérer un nombre important de patientes.
Dans ce système-là, il n’y en a que quelques-unes qui vont pouvoir le faire. Ça va laisser, comme on le dit dans notre podcast, une traînée de perdantes derrière. Certaines gagnent, mais il y en a beaucoup qui perdent. S’ils réussissent, c’est grâce à eux, s’ils échouent, c’est à cause d’eux. Et ça vient occulter totalement le système économique et social qui peut produire cette maladie.
France 3 : Justement vous soulevez dans ce podcast la question du nombre démultiplié de cancers depuis les années 90 et la question des polluants, notamment des polluants industriels…
Mandy Simoes et Jonathan Grondin : C’est une question qu’on ne soulève jamais parce que c’est considéré comme un problème individuel d’avoir un cancer. Par exemple, lorsque le corps soignant interroge un patient, vu que notre imaginaire est totalement captif et cantonné à la question de l’individu, il va poser des questions comme « est-ce que vous fumez ? », « est-ce que vous faites du sport ? », « est-ce que vous mangez bien ? ». Par contre, il va rarement demander s’il travaille dans une usine, s’il est confronté à des produits cancérogènes, etc.
Ce qui est terrible avec cette pensée très individualisante du cancer et de nos vies de manière générale, c’est que ça vient vraiment clore notre imaginaire sur la question de la responsabilité individuelle exclusivement. On ne va pas demander « est-ce que vous habitez à la campagne ? », « est-ce que là où vous habitez, il y a des champs et des pesticides épandus dans ces champs ? ».
Par exemple, j’ai un ami qui me racontait que lorsqu’il était petit, il habitait juste à côté d’un champ et que des avions d’épandage passaient et éjectaient des petites boules rouges. Lui, enfant, jouait avec. Si malheureusement cet ami tombe malade, personne ne va l’interroger là-dessus. Il n’y a pas d’enquêtes. Or il y a une explosion de cancers et ça doit nous interroger.
J’ai une patiente qui était coiffeuse, qui a 38 ans. Elle attribue son cancer à la séparation qu’elle a vécue qui n’a été pas si douloureuse que ça, il y a neuf mois. Elle ne l’attribue pas aux produits chimiques qu’elle utilise quotidiennement. Or si tout ça n’était en lien qu’avec le comportement individuel, quid des cancers pédiatriques ? Ils sont aussi en augmentation alors que les enfants ne fument pas, ne boivent pas. En fait, notre podcast, c’est vraiment une volonté de mettre à nu toutes les normes par rapport à la maladie et de permettre aux patientes de vivre et de s’orienter dans cette expérience d’une autre manière. On tient aussi à leur permettre d’entendre qu’elles ne sont pas seules à se poser des questions sur la culpabilité, le mal faire, la combativité ou la positivité.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse