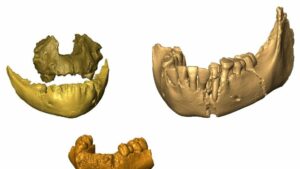Vous êtes biologiste, vous avez travaillé sur les fourmis et le blob. Comment vos recherches vous ont-elles menée aux champignons ?
Ma spécialité, c’est l’éthologie, l’étude du comportement animal. Je me suis beaucoup intéressée aux formes d’intelligence distribuée. Et au fil de mes recherches, je me suis retrouvée à travailler sur les interactions entre fourmis et champignons. Plus récemment, après avoir publié une étude sur les champignons du type Metarhizium – qui modifient le comportement de collecte alimentaire chez les fourmis – j’ai été contactée par Mathieu Vidard. Il venait de voir la série The Last of Us et m’a lancé : « Il faudrait absolument faire un livre sur ce concept ! » Le projet est né ainsi.
En quoi, selon vous, est-il pertinent de mêler fiction et vulgarisation scientifique ?
Ça facilite vraiment la compréhension. Mon ouvrage est assez dense, j’en ai bien conscience. La fiction permet au récit de respirer. Bien sûr, personne ne sera attaqué demain par l’Ophiocordyceps, comme dans le livre, mais cela permet de mieux saisir une réalité : une infection, même sans manipulation parasitaire, peut bel et bien survenir… et être dramatique. Souvent, on est attiré par la fiction pour son côté extravagant, mais la réalité, elle, est parfois encore plus folle.
Le champignon pathogène fictif inventé par Audrey Dussutour est directement inspiré de l’Ophiocordyceps. Ce dernier contamine les fourmis, qui perdent progressivement le contrôle de leur corps. © Katja Schulz/Flickr
Vous rappelez en début d’ouvrage que les animaux – et donc l’humain – partagent une parenté étroite avec les champignons. Vous dites par exemple que nous avons 50 % de notre ADN en commun avec les levures. Comment expliquer que ce soit si peu connu ?
C’est une bonne question, et honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’on me la pose autant. Personnellement, j’ai appris assez tôt dans mes études que les animaux et les champignons étaient liés. Mais il faut dire que cette parenté a été formellement reconnue assez récemment, en 1969. Finalement, c’est très récent. Ce manque de connaissance vient sûrement de là.
Vous décrivez certaines extinctions provoquées par des champignons, comme celles des châtaigniers d’Amérique ou des batraciens. Le changement climatique risque-t-il d’amplifier leur impact ?
Le réchauffement climatique va en effet sélectionner certaines espèces au détriment d’autres. On va perdre des animaux, mais aussi des champignons, qui sont généralement mésophiles – ils aiment des températures autour de 25 à 30 °C. Le souci, c’est que les espèces reines de l’adaptation, capables de résister aux fortes chaleurs, risquent de se développer. On le voit déjà avec Candida auris, responsable des mycoses. Mais le vrai problème, c’est la résistance aux médicaments : de plus en plus de souches échappent aux traitements, ce qui représente un danger réel, notamment pour les personnes immunodéprimées.
Si l’on fait le bilan, les champignons sont-ils plutôt des alliés ou des ennemis de l’homme ?
C’est très équilibré. Les champignons sont partout dans notre quotidien : ils permettent de fabriquer le pain, la bière, le chocolat, le café, les lessives… Mais ils sont aussi responsables de centaines de millions de tonnes de nourriture gaspillée à cause des moisissures. Côté santé, certains champignons tuent, d’autres sauvent – comme la cyclosporine, qui a permis de sauver des centaines de milliers de vies. Il y a toujours un Yin et un Yang chez les champignons.
Finalement, les grandes « apocalypses » que l’on observe sont souvent liées à l’Homme. Même si c’est un champignon qui tue, l’origine se trouve chez l’humain qui a amené un champignon là où il n’était pas présent.
Atelopus zeteki, ou grenouille dorée du Panama, a disparu en 2006 à cause du champignon Batrachochytrium dendrobatidis (dit Bd). Ce dernier a causé le déclin de 6,5 % des espèces de grenouilles dans le monde, soit plus de 500 espèces. © BY 2.0/ Brian Gratwicke/Wikimédia Commons
Finalement, les grandes « apocalypses » fongiques que vous décrivez trouvent souvent leur origine… chez l’homme ?
Oui. Même si c’est un champignon qui tue, c’est souvent l’activité humaine qui en est à l’origine. Nous déplaçons des champignons là où ils n’étaient pas censés être. Peut-être qu’au final, nous sommes moins sympas que les champignons…
Donc, ce qui vous inquiète le plus aujourd’hui, ce n’est pas tant le champignon en lui-même que la mondialisation et l’hyperconnexion humaine ?
Exactement. Au départ, je voulais parler uniquement de la manipulation comportementale – je trouvais fascinant qu’un champignon puisse utiliser son hôte comme une voiture télécommandée. Mais en creusant, je suis tombée sur toutes ces crises dont l’humain est indirectement responsable. Je ne veux pas faire la morale ; moi-même, je fais des erreurs. Mais j’avais envie de montrer que des gestes simples, comme laver ses chaussures en changeant de pays, peuvent vraiment prévenir des catastrophes.
Vous insistez aussi sur l’importance de financer la recherche en mycologie. Cela rejoint ces dangers que vous évoquez ?
Oui. Je me suis rendu compte, en travaillant sur ce livre, qu’on manque de données sur les catastrophes fongiques. Tout simplement parce que la mycologie est un domaine sous-financé. Un chercheur américain a avancé que c’était parce que les champignons n’étaient pas contagieux comme les virus, de façon aussi « dramatique ». Ils agissent sur le long terme, sans effet spectaculaire immédiat, donc ils attirent moins l’attention…
Votre ouvrage est dense, mais certains chapitres ont été supprimés et la fin reste ouverte. Envisagez-vous un tome 2 ?
Pourquoi pas. Il y a matière : environ 30 % des champignons sont des parasites. On a évoqué l’idée d’une suite, mais peut-être autour d’une autre famille, comme les décomposeurs, qui restent encore assez peu documentés.
On remarque que Sofia, l’une de vos héroïnes, glisse quelques piques féministes dans le récit. Ce n’était pas anodin, j’imagine ?
Non, du tout. C’est mon petit côté féministe. Il y a peu de femmes dans le domaine de la mycologie, et en tant que femme scientifique, je m’identifiais beaucoup à Laure. J’avais envie d’un personnage principal féminin fort et brillant, et que, cette fois-ci, ce soit la fille qui explique au garçon.
La chercheuse toulousaine est également l’auteure de L’Odyssée des fourmis (2022) et Moi, le blob (2022), pour lequel elle a obtenu le Prix Le Goût des sciences. © Ministère Enseignement supérieur et Recherche (YouTube)
>> Infos pratiques :
L’ouvrage Les champignons de l’apocalypse est paru le 16 avril dernier aux éditions Grasset.
Audrey Dussutour sera présente à la libraire Ombres Blanches, le mercredi 30 avril, à 18 heures.
>> À LIRE AUSSI : Deux chercheuses d’Occitanie primées par le Human Frontier Science Program